L’importance d’écouter sans couper la parole – Entre adultes (mais aussi avec les enfants)
- artvertisingcreation
- 8 sept. 2025
- 5 min de lecture

Lorsqu’un ami, un conjoint, un collègue ou un proche nous raconte un événement qui l’a blessé, il est fréquent que notre réaction, bien qu’animée de bonnes intentions, coupe l’écoute sans que nous nous en rendions compte.
Exemple concret
Imaginez cette scène :
« Mon amie revient du travail, visiblement bouleversée, et me dit : “Tu sais ce qui m’est arrivé ? Mon chef m’a humiliée devant toute l’équipe pendant la réunion.”
Face à ce récit, nous réagissons souvent selon des schémas automatiques, sans même en avoir conscience.Ces réflexes, bien qu’ils partent d’un bon sentiment, peuvent empêcher une écoute véritable.
1. Ramener à soi
« Oh, ça me rappelle, moi aussi, quand j’ai eu un patron horrible qui m’a fait la même chose. »
Ici, au lieu de rester centré sur l’expérience de l’autre, on la ramène à notre propre vécu.La personne se retrouve alors à écouter notre histoire, et son émotion n’est plus pleinement entendue.
2. Solutionner
« Franchement, tu devrais lui répondre la prochaine fois. Ou alors cherche un autre boulot, ça vaut pas la peine de rester. »
Nous avons naturellement envie de trouver une solution, de conseiller, de dire ce qu’il faudrait faire.C’est plus fort que nous :
« On veut solutionner. »
Mais en faisant cela, on prive l’autre de la possibilité de réfléchir par lui-même à ce qu’il veut vraiment, et de se réapproprier la situation.
3. Minimiser
« Oh, allez, c’est pas si grave. Les chefs font tous ça, tu sais. Tu verras, demain, tu n’y penseras plus. »
En minimisant, on balaie l’émotion ressentie.La personne se sent alors incomprise, et peut même ressentir de la colère ou de la tristesse, car son vécu est banalisé.
4. Philosopher
« Tu sais, dans la vie, tout arrive pour une raison. Peut-être que tu devais vivre ça pour apprendre quelque chose. »
Ici, on cherche à donner un sens à la situation.Mais au lieu d’apaiser, cela peut faire sentir à l’autre que sa douleur doit être dépassée ou justifiée trop vite, ce qui le prive de la possibilité de simplement être entendu.
5. Exagérer
« Quoi ?! Il t’a humiliée devant tout le monde ? Mais c’est inadmissible, c’est un tyran ! Tu devrais porter plainte ! »
Cette réaction dramatise l’événement et amplifie l’émotion de l’autre.Au lieu d’apaiser, elle augmente sa détresse ou le pousse à une réaction qu’il n’est peut-être pas prêt à assumer.
6. Zapper
Parfois, on change de sujet ou on passe rapidement à autre chose :
« Oui, c’est dur… mais bon, au fait, t’as vu le match hier soir ? »
Dans ce cas, la personne reste seule avec ce qu’elle ressent, sans avoir eu la possibilité de déposer son émotion.
Le point commun de toutes ces attitudes
« Et toutes ces attitudes qu'on a — minimiser, solutionner, ramener à soi, philosopher, exagérer, zapper — tout ça coupe l'écoute. »
Tant que la personne n’a pas eu la possibilité d’exprimer pleinement ce qu’elle vit, la blessure reste présente.
Pour permettre une véritable écoute, il est essentiel de prendre le temps et de poser des questions comme :
Comment tu t’es senti ?
Qu’est-ce qui s’est passé, exactement ?
C’était dans quel contexte ?
Qu’est-ce que tu aurais aimé dire ou faire ?
Et qu’est-ce que tu as fait finalement ?
« Il est temps de prendre ce temps, en fait. »
Pourquoi c’est si difficile ?
Dans notre société, depuis l’école, nous avons appris à fonctionner selon un schéma très simple :
« Il y a un problème, il faut une solution. »
Ainsi, quand quelqu’un nous dit :
« J’ai un problème »
… notre réflexe est de penser :
« Je vais lui apporter la solution. »
Mais souvent, nous n’avons pas la solution.En réalité, la personne qui a le problème détient aussi la solution.Pour qu’elle puisse la trouver, elle a avant tout besoin d’être écoutée.
Le rôle de l’écoute véritable
« Nous, on a besoin de se mettre en retrait et de pouvoir accompagner.Écouter, ça ne veut pas dire qu'on est d'accord, ça ne veut pas dire rester silencieux.On va poser des questions, on va interroger, considérer que l'autre est la personne la plus importante.Et lui laisser elle-même le pouvoir de trouver :– ce qui l'a blessée,– ce dont elle avait besoin,– et ce qui pourrait l'aider dans sa réparation. »
Pourquoi nous donnons des solutions : une réaction émotionnelle
Donner des solutions n’est pas seulement un réflexe culturel ou éducatif, c’est aussi une réaction émotionnelle face à notre propre inconfort.
Quand quelqu’un nous confie une difficulté, cela réveille quelque chose en nous :
Une inquiétude : « Oh non, je veux qu’il aille bien. »
Une peur : « Et si ça empire ? »
Ou même une culpabilité : « Est-ce que j’ai raté quelque chose ? »
Alors, pour apaiser notre propre anxiété, nous cherchons à « réparer » vite, à éteindre le feu.Souvent, donner un conseil ou une solution est notre manière de reprendre le contrôle de la situation.
Conseiller, c’est souvent projeter notre vécu
Quand on dit à quelqu’un ce qu’il « devrait » faire, on ne part pas de son monde intérieur, mais du nôtre.
En réalité, on lui transmet quelque chose comme :
« Voilà ce que moi, j’aurais fait dans cette situation, avec mon histoire, mes émotions, mes peurs et mes valeurs. »
En lui imposant notre vision, même subtilement, on risque de lui retirer sa liberté d’agir et sa capacité à trouver sa propre solution.
Ce que cela change dans l’écoute
Au lieu de chercher à calmer notre propre malaise en donnant des réponses toutes faites, l’idée est de rester présent à ce qui se passe :
Accueillir ce que l’autre ressent, même si cela nous met mal à l’aise.
Observer ce qui s’éveille en nous (anxiété, peur, envie de sauver) sans le laisser guider notre réaction.
Se rappeler que notre rôle n’est pas de résoudre, mais d’accompagner l’autre pour qu’il découvre sa propre voie.
C’est un travail intérieur, une forme d’apprentissage :
Apprendre à tolérer l’inconfort — celui de l’autre et le nôtre.
En résumé
Donner une solution apaise souvent notre propre stress, plus qu’il n’aide réellement l’autre.
Conseiller, c’est souvent projeter notre vécu, au lieu d’écouter vraiment celui de l’autre.
Une écoute profonde implique de laisser l’autre être lui-même, avec ses émotions, ses besoins et ses choix.
Écouter, ce n’est pas faire pour l’autre, c’est lui permettre de se rencontrer lui-même.

_edited.jpg)


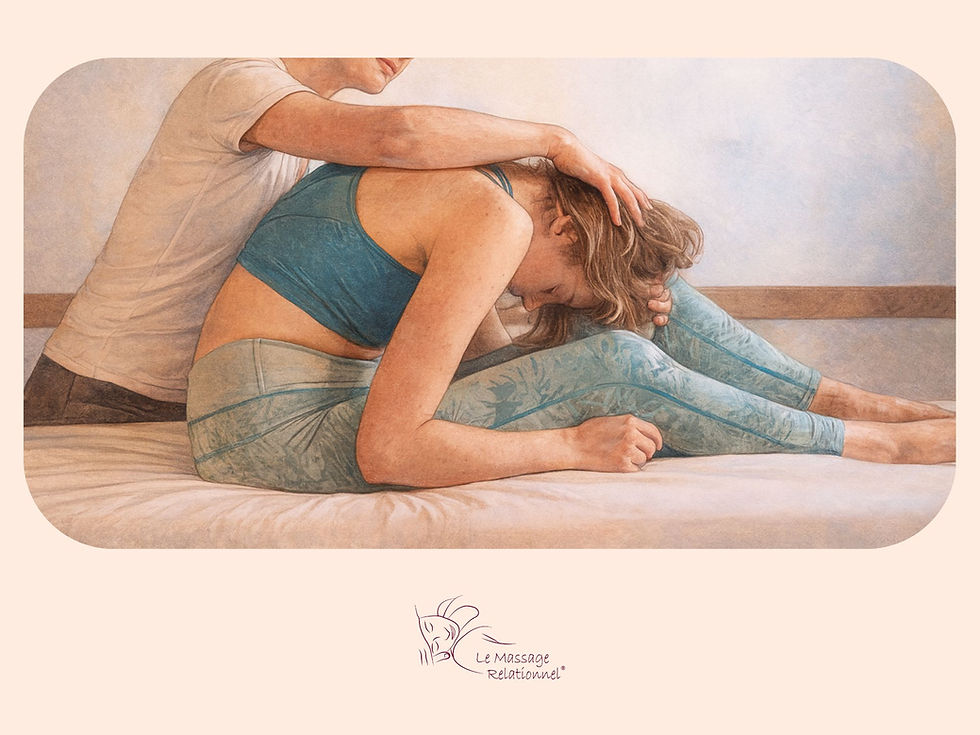
Commentaires